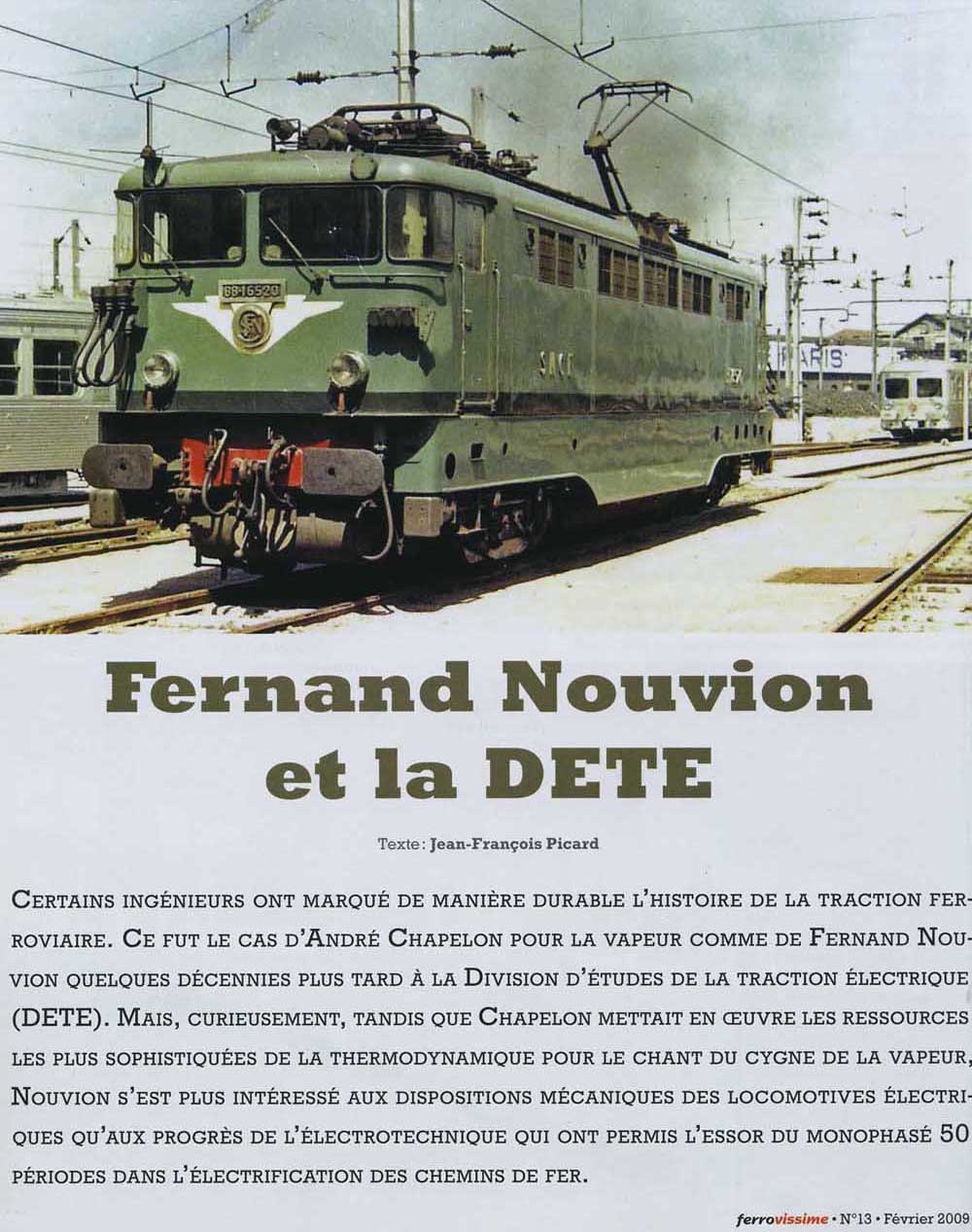Fernand Nouvion est né à Neuilly sur Seine en 1905. Son attirance pour le chemin de fer électrique remonte à sa prime jeunesse puisqu'il se voit offert à l'age de sept ans son premier train Märklin. Formé à l'Ecole supérieure d'électricité, aujourd'hui Sup'Elec dont il fera partie du corps enseignant, il cherche à entrer au chemin de fer au début des années 1930 et, naturellement, à la plus électrique des compagnies de l'époque, le P.-O. Mais là, on lui conseille de s'adresser plutôt aux Chemins de fer de l'Etat «...où l'on est moins regardant sur la qualité des candidats » ainsi qu'il aimait à le raconter. Sous la férule de Raoul Dautry, l'Etat est alors sur le point de lancer l'électrification de la ligne de Bretagne entre Paris Montparnasse et Le Mans. Le jeune ingénieur est affecté au service du Matériel, auprès de Marcel Garreau, le responsable de ce programme d'électrification. C'est ainsi qu'il participe à la mise au point de rames automotrices de ramassage, des engins aux fortes accélérations destinés à assurer une desserte omnibus rapide, mais ce qui l'amène à déplorer que les chemins de fe que le service de l'Exploitation des Chemins de fer de l'Etat ne s'intéresse guère à la vitesse.
Avec la nationalisation et après la défaite de 1940, Nouvion est nommé chef d'arrondissement 'matériel' des Batignolles sur la région Ouest de la SNCF, responsable des ateliers d'entretiens de La Folie à Nanterre. C'est là qu'il va donner la preuve de ses incontestables talents d'organisateur, non sans quelques conséquences fâcheuses dues aux circonstances. Les ateliers de la Folie sont chargés de la révision générale des locomotives de la ligne Paris-Le Mans, une opération qui ne nécessitait pas moins d'une quinzaine de jours en atelier. N'étant pas desservis par le réseau 1500 volts, mais par le 850 volts troisième rail de la banlieue Saint Lazare, les machines du dépôt de Montrouge y sont amenées par une BB d'origine 'Etat', la 822, équipée en bitension et de deux systèmes de captage. Nouvion y introduit de nouvelles méthodes de travail, imaginant une planification raisonnée des tâches d'entretien lesquelles consistent à travailler simultanément sur différents sous-ensembles de la locomotive, freins, contacteurs, etc., puis à effectuer un contrôle de qualité avant leur remontage. Il obtient ainsi une réduction à cinq jours du délai nécessaire à la révision générale des 2D2 5400, un résultat qui donne lieu en avril 1942 à son premier article publié dans la 'Revue générale des chemins de fer' sous le titre éloquent de 'réduction des immobilisations du matériel'. Mais dans la France occupée, la direction des transports militaires allemands est l'un des principaux clients de la SNCF et cette réduction d'indisponibilités lui bénéficie au premier chef. Bref, à la Libération, outre une adhésion non dissimulée à l'idéologie de Vichy, son zèle lui vaut d'être convoqué au dépôt des Batignolles où siège le comité d'épuration de la région Ouest. On lui reproche un comportement qui n'est pas sans rappeler le syndrome du 'pont de la rivière Kwaï', le célèbre film où un officier britannique fait prisonnier par les Japonais, pris au jeu de son métier, construit un ouvrage sur une ligne de Birmanie. Si cet épisode n'a pas nui à la carrière de Nouvion, il n'aimait guère en évoquer le souvenir.
Marcel Garreau, le patron de la DETE dans les années 1950 (coll. A. Blanc)
En 1946, il entre à la Division d'études de la traction électrique (DETE), un département créée par la SNCF à la veille de la guerre dans la perspective d'un ambitieux programme d'électrification du réseau ferroviaire. Sous la houlette de Marcel Garreau, son directeur, la DETE est appelée à jouer un rôle central dans la modernisation des chemins de fers français. Nouvion aimait à le rappeler : «on ne peut vivre le chemin de fer qu'en étant sans arrêt sur le terrain ». A l'époque la SNCF est seule à disposer d'un réseau qui lui permet de faire des essais en vraie grandeur et, surtout, des crédits nécessaires au développement de nouvelles techniques. Ainsi, pendant une trentaine d'années, la DETE va assurer la conception et la mise au point des nouvelles locomotives électriques de la SNCF. Il révèle ses capacités de meneur d'hommes, insufflant un véritable esprit de commandos à son équipe où l'on compte Marcel Tessier, André Cossié et quelques autres, imposant ses choix aux bureaux d'études des constructeurs. C'est ainsi que la DETE a été l'acteur de l'électrification des chemins de fer en monophasé 50 période. Mais l'affaire ne fut pas exempte d'aléas, notamment à cause de la mauvaise commutation provoquée au démarrage par la force contre-électromotrice des moteurs alimentés en courant alternatif. Parmi les solutions envisageables, Nouvion parie sur la mise au point de moteurs directs, c'est-à-dire utilisant directement le monophasé 50 périodes. Au lendemain de la guerre, la DETE suscite des essais réalisés en Allemagne sur la ligne expérimentale du Höllenthal avec une BB 'E 244' Siemens, mais dont le fonctionnement est réputé provoquer des feux d'artifices d'arcs électriques lors de la prise de vitesse, d'autres en Autriche sur les lignes de l'Arlberg et du Brenner afin de tester les performances des grosses CC 'E 94' de la Reichsbahn : « on faisait des démarrages lents en rampe qui torturaient les moteurs, raconte Marcel Teissier. Les machines crachaient des étincelles grosses comme des petits pois. Nouvion s'amusait à taquiner les Allemands, il 'occupait' la ligne. 'Attends coco ! J'ai pas terminé, on repart...' C'est comme ça qu'il nous est arrivé de coller six heures de retard à l'Orient Express qui attendait derrière ». Pour ces essais, la DETE dispose d'un train spécial composé de la voiture électrotechnique de la Reichsbahn et d'un ex-train spécial du Führer avec ses facilités de logement et de restauration : «on embarquait de nombreux invités se souvient Nouvion, les ingénieurs de Schneider-Westinghouse, d'Alsthom, d'Oerlikon, de Siemens à laquelle s'agrégeaient des officiers supérieurs des armées occupantes ainsi que des 'occupés' affamés. Comme on nourrissait bien nos gens, au fur et à mesure que nous circulions la foule croissait et bien que l'alcool servi à la fin du repas provienne en droite ligne de l'I.G. Farben, selon la déclaration du maître d'hôtel, les convives se déclaraient satisfaits du cinquante période. Certains insistaient même pour être invité à la cinquante et unième (!) ».
La E 244 à moteurs directs en tête d'un train sur la ligne du Höllental (DR)
Il n'empêche, ces essais convainquent Nouvion que le moteur direct est la solution pour développer la traction en 50 Hz. Pour la ligne de Savoie, la SNCF confie à la firme suisse Oerlikon le soin de fournir une CC '6051', tête d'une petite série de locomotives d'excellente facture, mais dont le prix d'achat et les coûts d'entretien se révèlent plus onéreux que celui des machines à courant continu. Lors du fameux congrès d'Annecy en 1951, les CC Oerlikon permettent à Louis Armand, convaincu par Nouvion, d'avancer que le moteur direct rend viable la technique du 50 périodes. Mais cette manifestation apporte aussi la révélation d'une innovation technique qui va se révéler décisive pour l'avenir du nouveau système de traction, l'ignitron. Il s'agit d'un redresseur statique qui permet de transformer l'alternatif monophasé fourni par la caténaire en courant continu avalé par les moteurs de traction. L'électrification de la ligne Valenciennes - Thionville suscite donc la commande d'une quinzaine de BB 13000 à moteurs directs, mais aussi de cinq BB 12000 à ignitrons dont les performances vont justifier pendant des décennies suivantes l'incontestable suprématie des machines à redresseurs. Ainsi, lors d'un nouveau congrès électrotechnique organisé à Lille en 1955, Nouvion peut évoquer la supériorité des machines à quatre essieux de la SNCF sur celles à six essieux de la Bundesbahn. Quiqu'il en soit, la réussite de son programme d'électrification incite la DETE à institutionnaliser une collaboration internationale pour susciter la constitution d'un 'Groupement du 50 Hz' avec les Allemands (AEG, Siemens), les Suisses (Brown-Boveri), les Belges (Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi) et bien entendu, Alsthom, Jeumont-Schneider et 'SW'. Le groupement 50 Hz donne à Nouvion l'occasion d'exercer ses capacités de vendeur. Ainsi, il travaille à l'électrification de la banlieue d'Istanbul, à l'électrification des chemins de fer portugais et il participe à la conception de locomotives destinées à l'URSS et à la Chine. En extrême Orient, il anime une mission technique chargée d'électrifier les 'Indian Railways'. La 1100ème locomotive que leur livre le groupement 50 Hz est solennellement baptisée 'Fernand Nouvion', un hommage dont il était très fier.
En réalité, même s'il a participé à l'épopée technique du 50 périodes, Nouvion était plus attiré par la mécanique que par l'électrotechnique. Dans une conférence donnée à l'Ecole polytechnique en 1956, il affirmait que : « le plus important dans une locomotive, ce n'est pas le mode de traction, mais la partie mécanique dont l'électricité ne doit être que le serviteur ». Rappelons que dès les lendemains de la guerre, la DETE s'est intéressée à la conception de locomotives électriques de vitesse à adhérence totale. Jusque-là les locomotives de ce type proposées par les constructeurs étaient de type 2D2, c'est-à-dire équipées de moteurs entièrement suspendus, mais dans un châssis rigide, et munies de bogies porteurs. En fait, l'innovation est venue de Suisse lorsqu'en 1942, la compagnie du 'Bern-Lotschberg-Simplon' a mis en service quatre BB 251 à moteurs entièrement suspendus aptes à courir à plus de 120 km/h pour un poids de 80 tonnes et une puissance de 4000 chevaux. En France, alors que débute l'électrification de la ligne Paris - Lyon pour laquelle le service 'Matériel et Traction' (MT) préconise l'acquisition de lourdes 2D2 9100, la DETE envisage la construction de locomotives de vitesse à adhérence totale, la première étant la CC 7001 Alsthom. Puis, à la suite de la fourniture par Brown Boveri de deux BB légères, Marcel Garreau passe commande chez Schneider de deux locomotives équipés d'une transmission à anneaux dansants conçue par l'ingénieur André Jacquemin de la DETE (9003 et 4).
Fernand Nouvion (à g.) en compagnie d'Ange Parmantier, le directeur du Matériel et de la Traction de la SNCF, lors des essais de 1955 dans les Landes (DR)
En mars 1955, lorsque la CC 7107 et la BB 9004 sont mises à contribution pour franchir la barre des 300 km/h sur la ligne des Landes, on doit évoquer les enseignements que Nouvion a tiré de ces essais : « sur la CC, outre les problèmes de captage qui ont interrompu prématurément la tentative, on a eu des problèmes de transmissions. Au cours de l'essai, on a commencé à percevoir une odeur de brûlé, indice de la destruction des silentblocs de la transmission Alsthom. A l'arrêt à Morcenx, on pouvait nettement déceler le fluage des bielles de transmission consécutif à la disparition du caoutchouc des silent-blocks… Autre problème, le lendemain avec la BB, lorsqu'on a atteint les 331 km/h, au moment de la commande 'couper courant', les accélérations subies par la loco ont brusquement changé de nature. Il s'est produit une sorte de mouvement de tamis qui a duré de manière pénible pendant une dizaine de secondes. On a cru à une nouvelle avarie de transmission et, je le reconnais, j'ai craint le déraillement. En fait, ce n'était pas elle qui était en cause, mais c'est la coupure brutale de l'effort de traction qui a provoqué ce mouvement incontrôlé (et cette déformation de la voie que l'on aperçoit sur certaines photos prises après les essais, cf. infra). Les appareils de mesure avaient enregistré des accélérations de 0,25 G sur la machine et une poussée de six tonnes sur le rail, le tiers de la valeur de la charge sur l'essieu… En fait, l'essai de la BB nous a montré la nécessité de monter sur les bogies des amortisseurs anti-lacets à action rapide, un dispositif mis au point par un fabricant hollandais (Koni) qui sera adopté ensuite sur tout le matériel SNCF… Quant au problème de captage, je dirais qu'en 1990 le TGV a battu son record de 515 km/h en prenant 700 Ampères à la caténaire, moi, j'en avais pompé plus de 5000 avec la CC ! La conclusion était claire, il fallait passer au monophasé haute tension ».
Le fluage des biellettes de la transmission Alsthom sur la CC 7107
La déformation de la voie après l'essai de la BB 9004 (clichés AFAC)
Ses réflexions de mécanicien ont conduit Nouvion à envisager la conception d'une locomotive universelle, apte aussi bien à la traction des trais de voyageurs à grande vitesse qu'à celle de lourds convois de marchandises. En 1958, lorsqu'il présente les BB '16500' conçues pour l'électrification de la ligne Paris - Lille, il n'hésite pas à parler d'un concept révolutionnaire en matière de traction ferroviaire. De fait, ces machines présentent un certain nombre de caractéristiques originales qui assurera leur large diffusion. Dotées de bogies monomoteurs, avec son collaborateur Louis Lothion, il a eu l'idée de les équiper d'une transmission à double rapport d'engrenages. Grâce à un dispositif manoeuvrable à l'arrêt, les '16500' se présentent comme des engins polyvalents, capables d'assurer à 90 km/h la traction d'un train de marchandise de 1500 tonnes et de courir à 140 en tête des trains de voyageurs. Dans un cas, le rapport basse vitesse augmente leur couple, dans l'autre cas d'économiser 1000 ch. de puissance lors de la traction d'un express à 140 km/h. Ces locomotives capables de fonctionner en unités multiples sont rapidement devenues omniprésentes sur le réseau SNCF avec près de trois cents '16500' puis cent '17000' pour le monophasé 50 période, cent soixante dix '8500' pour le continu 1500 volts et près de deux cents '25000' bicourants. Mais d'autres séries de machines ont bénéficié de bogies monomoteurs à bi réduction, les petites '9400' de 60 tonnes, mais aussi les CC 40100 capables de courir à 160 et 240 km/h engagées sur les rapides internationaux de la région Nord. Enfin, les CC '21000' bicourants et surtout leurs dérivées en 1500 continu, les puissantes '6500' classées comme machines mixte par le service M-T (100/220 km/h), engagées au début de leur carrière en tête des trains drapeaux du sud-ouest, 'Capitole', 'Aquitaine', et au sud-est sur la ligne de la Maurienne où elles assurent le trafic avec l'Italie.
Bogie monomoteur d'une CC 40100 (Sciences et Vie, spécial chemin de fer, 1972)
Reste que le concept de bogie monomoteur à bi réduction n'a pas manqué de susciter certaines critiques. La mise au point des BB '16500' a requis la participation active et a provoqué la grogne des ateliers de la SNCF. Lors d'une réunion organisée par le service M-T à Salins-les-Bains au début des années 1960, les participants se souviennent d'un Nouvion montant au créneau pour défendre ses conceptions : « personne au monde n'est capable de faire une machine aussi légère, aussi performante, aussi universelle que la '16500' et si vous avez des problèmes c'est que vous ne savez pas les entretenir », ce qui comme on l'imagine ne manqua pas de provoquer quelques remous dans l'assistance. De même, leur tenue de voie vacillante due au faible empattement de leurs bogies et à la raideur de leurs suspensions leur ont valu des tractionnaires le sobriquet de 'danseuses'. En effet, la complexité du bogie monomoteur à bi réduction requiert des normes de fabrication élevées et la cascade des quatorze engrenages de la transmission des '6500', outre un suivi attentif en matière d'entretien, implique, du fait de leur faible taux de giration, de circuler sur une voie impeccablement dressée. En 1977, c'est ce que révèle l'envoi d'une CC '21000' envoyée outre-Atlantique pour des essais demandés par la compagnie 'Amtrak' sur le corridor Boston - Washington. L'échec de la CC Alsthom pénalisée par la rusticité de la voie nord-américaine incitera finalement la compagnie américaine à s'équiper de plus classiques BB suédoises (ASEA).
La CC 21004 devenue X 996 fait ses premiers tours de roues dans l'emprise de l'usine Althom de Belfort (cl. GEC Alstom)
En 1971, lorsque Jean Dupuy devient directeur du service du Matériel de la SNCF, il entend revenir sur le concept de bi réduction dont il nie l'intérêt économique, « des bogies à deux rapports d'engrenage ne servent à rien si on relève la vitesse des trains de marchandise de 90 km/h à 120 Km/h puisqu'on perd ainsi le bénéfice d'une économie de 8% sur le nombre de machines du parc » et il convie la DETE à concevoir des locomotives conçues pour ne requérir que le minimum d'entretien. Cette nouvelle politique donnera les 'BB 15000' en 50 Hz et leur déclinaison en courant continu, '7200' et bicourant '22200', des machines conçues par André Cossié, Fernand Nouvion et Raoul Dupont, dotées de bogies monomoteurs, mais sans bi-réduction. Les 'nez cassées' ainsi appelées à cause de leur pare-brise inversé et de leurs petits capots bénéficient d'améliorations qui en font la série de locos électriques la plus réussie de la SNCF. Leurs moteurs bénéficient de nouveaux isolants, du soudage TIG des lames de collecteurs et d'une ventilation forcée qui les rendent à la fois plus robustes, plus puissants et plus légers. «Désormais, on peut piloter un moteur électrique simplement en surveillant la température de son collecteur » constate Nouvion, finissant par admettre que la polyvalence d'une locomotive peut aussi reposer sur sa partie électrique.
Peyrehorade, une BB 7200 en tête d'un train régional se dirige vers Bayonne
Le promoteur de la grande vitesse sur rail a-t il participé à la genèse du TGV ? Ce n'est pas le cas, au moins directement. Il est vrai que le TGV avec sa rame articulée et insécable et son infrastructure dédiée ne correspondent pas aux pratiques de la DETE motivée par la traction de trains lourds sur le réseau classique. Lors de l'élaboration du prototype '001' à turbines à gaz, Nouvion propose un TGV à bogies monomoteurs qui ne semble guère avoir retenu l'attention. Plus tard, il critiquera certaines dispositions comme la choix de moteurs synchrones pour le TGV Atlantique et leur chaîne de traction à thyristors : « un dispositif contre-nature, dit-il, qui transforme le courant monophasé en triphasé… Des trucs en 'trons' et en 'stors' tellement compliqués qu'ils en deviennent un facteur majeur de pannes ». Pourtant, cette chaîne de traction aura permis d'atteindre l'universalité par l'électronique de puissance avec les BB 26000 dont la puissance maximale est développée à 90 comme à 200 km/h. Evidemment, derrière l'ironie perçait l'amertume de ne pas avoir terminé sa carrière à la direction 'M-T' de la SNCF. Il n'en reste pas moins que sa carrière comme celle de ses collègues de la DETE illustre la glorieuse époque où la société nationale était l'acteur principal de l'innovation ferroviaire, une situation qui a profondément évolué aujourd'hui, comme l'on sait. Reste que sans le rôle crucial tenu par les ingénieurs de la SNCF dans le passé, il n'y aurait vraisemblablement pas de TGV aujourd'hui, c'est-à-dire un train électrique ultra rapide circulant sur une infrastructure dédiée aux grandes vitesses.
Retour